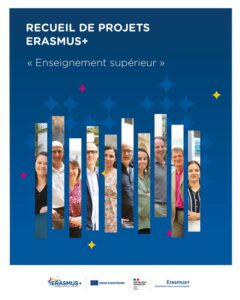Qu’elles soient physiques, virtuelles ou hybrides, les mobilités Erasmus + offre de nombreuses possibilités aux établissements de l’enseignement supérieur. Bénédicte Mahé, responsable des relations internationales aux Beaux-Arts de Paris, et Aurélie Bac, directrice adjointe du pôle des relations internationales à l’Université Polytechnique Hauts-de-France, livrent leurs éclairages et conseils.
Bénédicte Mahé : Je recommande tout d’abord de lire le guide du programme qui récapitule toutes les règles, ainsi que les annexes de la convention. Ensuite, il est important de bien connaître les plateformes de gestion, les outils. Cela nous permet de réfléchir dans le cadre et de mieux guider nos étudiants.
Autre recommandation : ne pas hésiter à contacter son chargé d’accompagnement au sein de l’agence Erasmus+. Je me souviens l’avoir fait pour le financement des participations à un programme intensif hybride (blended intensive programme – BIP), lorsque cette activité de mobilité a vu le jour. Les personnels de l’agence sont très disponibles et nous permettent d’obtenir des réponses fiables rapidement.
Que les participants aux mobilités soient étudiants, personnels administratifs ou enseignants, il est essentiel de bien communiquer auprès d’eux en amont, pendant et après la mobilité. J’encourage également à être transparent sur ce qu’ils doivent faire et fournir ainsi que sur les questions de financements et les différentes contraintes.
Enfin, il est essentiel d’être positif, enthousiaste et rassurant dans notre accompagnement ! Certains peuvent être stressés par leur départ, surtout lorsque c’est la première fois qu’ils quittent le cocon familial. À nous de les accompagner dans ce moment privilégié de leur parcours.
Aurélie Bac : Je dirais qu’il faut effectivement être attentif sur les trois phases : avant, pendant et après la mobilité. Avant, la première chose, c’est de mettre en place de bons moyens de promotion : valoriser les compétences et l’expérience que les mobilités vont pouvoir apporter, tant aux étudiants qu’aux personnels, tout en étant réaliste sur ce qu’implique une mobilité. Pour une université de notre taille, avec 14 000 étudiants, la promotion passe en partie en central, au niveau du pôle des relations internationales, mais il est indispensable de bénéficier également de relais au niveau des enseignants et des secrétariats, qui sont davantage en contact avec les étudiants. Pour les personnels, de la même manière, il est important que la direction générale des services et les services RH promeuvent les mobilités.
Pendant la mobilité, il est nécessaire de mettre en place un suivi, même si les étudiants nous oublient parfois un peu ! Il faut cependant leur rappeler que nous sommes là au besoin, via des canaux clairement identifiés – qu’ils disposent de numéros d’urgence en cas de problèmes par exemple.
Enfin, après la mobilité, la reconnaissance est importante. Elle doit être identifiée en amont : quelle activité et quelles compétences doivent être valorisées et à travers quels dispositifs de reconnaissance ?
B.M. : Je pense que désormais, les professionnels des relations internationales ne pensent plus seulement le programme Erasmus+ en termes de mobilités. C’est un outil multi facettes qui permet aussi de financer des workshops ou de développer la coopération. Il nous permet de penser au-delà des mobilités.
A.B. : Les mobilités courtes hybrides proposent de nouvelles opportunités, que notre établissement a prises en main. Une vingtaine de programme intensifs hybrides (BIP) sont ainsi organisés chaque année par nos partenaires. Ce format permet de toucher les étudiants qui sont le plus éloignés de la mobilité, notamment ceux en apprentissage. Ce sont des opportunités vraiment intéressantes.
B.M. : Aux Beaux-Arts, nous ne sommes pas très concernés. La pratique artistique nécessite vraiment une présence physique : les sculptures, les installations, etc. Le virtuel ne va pas pouvoir la remplacer. On s’en est rendu compte après la période de pandémie de Covid et nous sommes majoritairement revenus à des mobilités physiques. Néanmoins, il permet une première approche ou la continuité d’une mobilité physique.
A.B. : Les mobilités virtuelles permettent de toucher davantage de participants. Pour certains, elles peuvent représenter un premier pas vers l’international, pour d’autres, elles s’inscrivent dans la continuité de leur mobilité physique. Elles sont alors complémentaires de l’expérience internationale qu’elles viennent compléter.
B.M. : Absolument. Nous accueillons 25 % d’étudiants internationaux au sein de notre programme diplômant. Ils ne suivent pas de programmes à part : ils sont complètement intégrés aux ateliers. Chaque atelier accueillant un ou deux étudiants internationaux seulement, cela favorise leur intégration parmi nos étudiants et confère une dimension internationale aux discussions, aux approches et échanges de points de vue. Pour les personnels internationaux accueillis, c’est pareil : cela crée des moments précieux d’interculturalité, insuffle un vent de changement et une dynamique certaine. Ces expériences permettent de faire un pas de côté sur nos propres pratiques.
A.B. : Nous essayons également de promouvoir l’internationalisation à domicile, qui profite à tous ceux qui ne peuvent pas partir. Accueillir des enseignants ou des personnels internationaux créé un environnement interculturel, ouvre sur de nouveaux regards, et apporte des pratiques innovantes. C’est très important, notamment pour le personnel administratif et technique de notre Université européenne. Tous ne pouvant pas partir en mobilité, accueillir un collègue international dans un service permet de toucher toute l’équipe. C’est ce qui s’est passé, par exemple, pour notre service commun de documentation.
B.M. : Nous réservons les mobilités physiques à des mobilités longues et nous essayons de promouvoir au maximum les éco-transports. Concernant les programmes intensifs hybrides, les pays accessibles en train sont privilégiés pour les workshops de cinq jours. En parallèle du questionnaire Erasmus, nous avons développé un questionnaire de retour de mobilité comportant une vingtaine de questions, dont une portant sur les bonnes pratiques environnementales de nos établissements partenaires. Les réponses sont une source d’inspirations.
A.B. : Nous essayons de privilégier les mobilités virtuelles ou les partenariats qui permettent d’utiliser les mobilités douces. Notre Université européenne compte parmi ses membres l’Université de Mons, située en Belgique. Même avec une distance géographique faible, une mobilité à Mons permet de se confronter à une culture différente.
Enseignement supérieurMobilitésInternationalisation